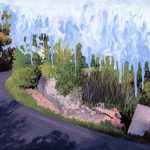ENTRETIEN / entre Jean-Charles Eustache et Jean-Charles Vergne directeur du FRAC Auvergne et commissaire des expositions FROM DUSK TO DARK et FROM DARK TO DUSK
ICI, NOUS NOUS REUNIRONS ET NOUS NOUS SOUVIENDRONS DU PASSE
Jean-Charles Eustache : Je suis né au lieu dit « La Retraite » dans la commune de Baie-Mahault, en Guadeloupe, en 1969. A l’époque, c’était une petite bourgade recouverte de champs de cannes à sucre. Un petit réseau ferroviaire permettait d’acheminer la récolte de canne jusqu’à une balance – c’était une arche métallique. Les ruines que l’on aperçoit dans This Is The Way The World Ends1 sont les vestiges d’un moulin à eau qui entrait dans le processus de traitement de cette canne à sucre. Lorsque j’étais encore enfant, cette activité périclitait déjà.
J’ai perdu l’oeil droit qui était atteint d’une cataracte alors que j’étais encore nourrisson. Quelques années plus tard, il a fallu énucléer cet oeil invalide pour le remplacer par une prothèse. Mon oeil gauche possède une acuité visuelle faible – un dixième et demi – et il est suivi pour un glaucome. Mon champ visuel est donc plutôt catastrophique. Pour compenser la vision périphérique, cet oeil est sujet à un strabisme prononcé qui peut dérouter quelquefois mes interlocuteurs. Cette cécité était un frein à mon éducation dans les classes préparatoires. Je me souviens qu’une professeure avait tenté de me mettre sur l’estrade, à côté de son bureau, afin que je puisse mieux suivre les cours au tableau, mais cela se révéla sans succès. Les rapports avec les autres élèves n’étaient pas aisés et j’accumulais du retard… On se résolut à m’envoyer dans un centre spécialisé à Clermont-Ferrand, en 1977 ; j’avais alors huit ans.
C’est ainsi que je suis arrivé en Auvergne et que je suis devenu pensionnaire d’une institution pour malvoyants. A cette époque, la politique d’intégration n’était pas aussi avancée qu’aujourd’hui. C’est pour cette raison que de nombreux enfants aveugles ou malvoyants en provenance des DOM et de régions plus ou moins reculées se retrouvaient pensionnaires ou demi-pensionnaires dans ce type d’établissement. J’ai effectué toute ma scolarité dans cet établissement. La directrice de cette institution n’était guère favorable à ce que j’opte pour un Bac artistique après la seconde. Je me suis donc orienté vers un Bac L car j’aimais la littérature. J’avais pu intégrer le journal du lycée, ce qui était une petite victoire car on m’avait sollicité pour y produire des illustrations. En ce temps, on ne parlait pas d’inclusion, mais c’était vraiment gratifiant de pouvoir participer à la vie d’un lycée alors que j’avais été confiné pendant des années dans le cadre fermé de cet organisme. Pour des raisons qui m’échappent et que je préfère ignorer, cette école persiste à ensemencer un singulier cauchemar qui me hante, à l’improviste, depuis des années.
J’ai toujours aimé dessiner mais je n’avais qu’une vision biaisée de ce qu’était l’art, la peinture – ce n’était pas pour moi. Si j’avais pu être dessinateur de bandes-dessinées, j’aurais été un être comblé. Mais dans les années 1980, la bande dessinée était réellement exécrée, par le milieu familial et encore plus par le monde éducatif, considérée comme trop régressive ! Plus jeune, j’ai souvenir que c’était dans la clandestinité que je devais feuilleter quelques comics. Le plus triste dans cette histoire, c’est que cela fait plus de vingt ans que je n’arrive plus à lire une bande dessinée. N’est-ce pas ironique comme situation ?
J-Ch. V. Comment la peinture est-elle arrivée dans votre vie ?
J-Ch. E. La peinture n’a fait son apparition que progressivement dans mon parcours. Par petites touches. D’abord discrètes, puis par pans entiers. Il est compréhensible que dans un établissement pour déficients visuels, on n’ait guère prodigué des cours de dessins à des malvoyants. Nous avions plutôt des professeurs de piano, de guitare, d’accordéon ou de clarinette. Comme la plupart des élèves de cet établissement, j’ai suivi des cours de piano ainsi que l’apprentissage du Braille. Il me semble que l’essentiel de cet enseignement se résume ainsi : toucher le monde, du bout des doigts, puis l’embrasser par la pensée. Les amblyopes (ou malvoyants) sont dans une situation inconfortable, car ils entrevoient ce monde et, en même temps, ils sont conscients que le monde qu’ils perçoivent est lacunaire. La première peinture que j’ai vue en arrivant en Métropole était une reproduction d’une des jungles du Douanier Rousseau. La peinture s’est toujours tenue à distance de moi – ou peut-être est-ce l’inverse ? Une crainte respectueuse devant un objet sacré, inaccessible. Toujours est-il que, tout au long de mon enfance, c’est par « écrans interposés » que je voyais les tableaux. Au centre pour malvoyants, c’est par un phénomène comparable à un coup de dés que je pouvais découvrir une peinture : c’était tantôt un poster dans une salle commune (je songe à un triptyque de Francis Bacon qui longtemps m’intrigua), tantôt des reproductions dans les livres scolaires – je songe aux illustrations des manuels de français Lagarde et Michard ou à ces Vasarely reproduits dans les manuels scientifiques. En Guadeloupe, mes parents avaient eu l’extraordinaire idée de se procurer les tomes illustrés du Robert. Je feuilletais les pages de ces volumes avec volupté. Tant d’étranges univers, tant de plages, de récifs ou de bois où mon imagination pouvait se repaître de formes nouvelles, de propositions inouïes. J’étais conquis par certaines visions, mais j’étais bien loin d’imaginer que certaines images renfermaient des secrets encore plus enivrants.
Il me semble que c’est en 1991 qu’un jour je me suis hasardé à franchir les portes du FRAC Auvergne. Il y avait des peintures de Jean Dubuffet. Je crois que c’est à cet instant que j’ai « vu » des peintures « en chair et en os ».
J-Ch. V. Vous voulez dire que c’est au FRAC Auvergne que vous avez vu des oeuvres pour la première fois de votre vie ? Nous nous connaissons depuis quelques années et j’étais loin d’imaginer cela ! Que s’est-il passé lors de cette première découverte ? Cela relève-t-il d’une forme d’épiphanie ? Ou, au contraire, les choses se jouent-elles plutôt dans un effet à retardement ? Je voudrais également souligner une particularité qui vous est propre, dans votre manière d’approcher et de regarder une oeuvre. Votre handicap vous oblige – je vous ai observé à de nombreuses reprises dans les salles d’exposition du FRAC depuis des années – à vous placer au plus près de la surface des peintures – deux ou trois centimètres, pas davantage – pour les regarder, et je dirais même pour les scanner, ce qui me paraît être le terme le plus approprié. Parlez-moi de cette façon singulière de parcourir une surface.
J-Ch. E. En réalité, c’est au cours d’un voyage à Colmar, un an plus tôt, qu’il m’avait été possible d’approcher une oeuvre pour la première fois. C’était le retable d’Issenheim de Matthias Grünewald. Mais comme vous me le faisiez remarquer, afin que je puisse lire un tableau, il me faut l’approcher d’assez près. Ce qui explique que cette première expérience se limita au déchiffrement de la partie inférieure du panneau représentant l’agression de Saint Antoine par les démons. Aussi n’ai-je pu apprécier les subtilités anatomiques tant commentées du Christ en croix puisque le motif était placé trop haut. Je crois me souvenir que ce premier contact avait été pour moi plus littéraire que pictural. J’avais été bien plus captivé par la vision cauchemardesque que le peintre avait déployée que je ne l’avais été par les propriétés picturales du panneau. Le vernis qui recouvrait cette apparition infernale me confortait dans l’idée que je me faisais de la « peinture » à cette époque – des images vitrifiées sous le voile d’une matière brunâtre et organique. Donc j’abordais cette oeuvre sous son versant littéraire (Flaubert avec sa Tentation de Saint-Antoine ou Antonin Artaud dont je venais de parcourir le Théâtre et son double). Paradoxalement, si le retable constituait une forme de baptême, il est tout à fait juste de comparer ma première visite au FRAC Auvergne à une sorte d’épiphanie ou de « transfiguration », en ce que la peinture se révélait sous sa nature la plus efficiente – elle devenait matière à part entière. Aux débuts des années 1990, le FRAC était niché aux Écuries de Chazerat, ce qui lui conférait un aspect moins intimidant pour un curieux de mon espèce. Non seulement les peintures de Jean Dubuffet étaient accrochées à hauteur d’homme, mais elles m’offraient un spectacle jusqu’alors inconnu. Si je fais appel aux souvenirs de cet après-midi là, je revois un ondoiement de motifs entrelacés. Certains tableaux grouillaient de figures enchâssées dans un magma crayeux. C’était fabuleux dans un sens car jamais je n’avais vu de tels sillons creusés à même la peau de l’image. Grâce à ces toiles, je passais du simulacre de la carnation blafarde et bubonique des démons du retable d’Issenheim à la pulpe palpitante d’une peinture incarnée.
Cette expérience devait me marquer définitivement car, à partir de cet instant, je n’ai cessé d’écumer les centres d’art et les musées dès que l’occasion se présentait. Patiemment, je commençais à former mon regard. Pendant huit ans, j’assouvissais ma passion en examinant minutieusement des peintures aussi variées que les âpres fonds d’Henri Fantin-Latour, les paysages crémeux de Jean-Baptiste Camille Corot, les surfaces lumineuses d’Henri Matisse ou les projections foudroyantes de Francis Bacon. C’était une forme de boulimie que j’attisais en collectionnant des cartes postales collectées aux grès de mes voyages. En néophyte, je me cantonais à la peinture impressionniste et moderne. La peinture contemporaine ne s’est imposée que plus tardivement. Le musée des beaux-arts de Lyon et le Louvre étaient mes deux terrains de chasse favoris. Les vertus de la fréquentation des tableaux de maîtres n’est pas un mythe. Et même pour les fous de peinture, la visite d’une oeuvre est aussi chaleureuse que la visite faite à un ami. De gourmandise, je pouvais enchaîner dans une même journée la visite d’une rétrospective consacrée à Paul Cézanne puis la visite d’une section du Louvre. Je suis vraiment heureux d’avoir pu contempler l’extrême délicatesse des petites toiles de Jean Siméon Chardin. En définitive, ce que je traque dans l’observation d’une peinture, et cela quelle que soit sa provenance ou son époque c’est, bien entendu, sa texture mais aussi sa structure formelle. J’aime à deviner comment la peinture s’aventure puis se déploie sur la toile, strate par strate, bloc par bloc. Je pense avoir été toujours fasciné par la coexistence de plusieurs éléments dans un même ensemble : la pluralité des niveaux de lecture d’un même récit ou la superposition de deux ou trois récits. Avant de m’intéresser à la peinture proprement dite, je chérissais des auteurs de bande dessinée comme Fred avec son Philemon, ou Bill Sienkiewicz avec sa saga Elektra. L’irruption de styles différents venait parasiter le cour de la narration ; la linéarité du récit était soudain sapée par des images exogènes ou par un graphisme parfois dégénéré et d’autres fois classicisant. Pour en revenir à la peinture, c’est pour cette raison que les toiles de Raoul de Keyser interpellent tant le regard des peintres. Raoul de Keyser montre comment ses créatures ont été conçues, non seulement par l’hétérogénéité de sa production mais en disséminant quelques indices en lisière des oeuvres. Une peinture qui vous donne à réfléchir sur sa structure interne est peut être comparable à une belle formule mathématique. Mais on peut aussi le voir comme une affaire criminelle à résoudre – l’image est certes un peu triviale mais elle possède au moins l’avantage d’être parlante, surtout depuis la démocratisation des méthodes d’investigation scientifique. La multiplication des radiographies dans les ouvrages d’art en est une illustration pertinente. Donc, c’est un peu vrai, je scanne, à ma manière, mais je l’espère avec un oeil encore empreint d’humanité.
Cependant, bien que mon regard se soit progressivement enamouré de la peinture, je n’imaginais pas entreprendre des études d’art. C’eut été de la folie. C’est sur les conseils enthousiastes d’un de mes amis que j’ai fini par surmonter mes complexes et m’inscrire au concours d’entrée aux Beaux-arts de Clermont-Ferrand. Trente ans, c’était l’âge de la dernière chance, me suis-je dit, bien qu’une petite voix intérieure continuait à me susurrer quelques ritournelles de cet acabit : « Et ta vue, t’y penses ? », « Il est trop tard mon vieux » ou encore « Tu n’as aucun bagage culturel pour cela, le sais-tu ? » Et si j’avais su que des candidats se présentaient à ce concours après avoir suivi une année de préparation, cela n’aurait fait qu’accroître mes craintes.
J-CH. V. Votre peinture a très vite été marquée par la question du souvenir, dans une pratique principalement fondée sur la réalisation de paysages exécutés sur des formats de petites dimensions. Ces paysages sont souvent corrompus par une forme de désagrégation liquide de la surface, comme une pellicule photographique dont la gélatine aurait partiellement fondu, oblitérant certaines zones de la représentation. On sait désormais par les neurosciences que plus nous convoquons un souvenir, plus celui-ci fait l’objet de corrections inconscientes, d’ajouts et de retraits, de recadrages et de falsifications. En d’autres termes, il semblerait que nos souvenirs possèdent un capital d’authenticité limité, qu’ils soient condamnés au délitement au fil de leurs utilisations successives. Entre l’oblitération visuelle de vos représentations et l’étiolement mémoriel dont nos souvenirs sont les victimes, votre peinture semble s’inscrire dans un rapport de déliquescence inéluctable des choses, ce que paraît souligner par ailleurs la mélancolie affleurante des titres que vous choisissez.
J-CH. E. Ce mécanisme de délitement de la mémoire m’évoque les séquences d’un film auquel je tiens beaucoup, The Swimmer de Frank Perry, sorti en 1968. En premier lieu, parce qu’il illustre avec maestria ce petit théâtre où notre mémoire aime à mettre en scène nos souvenirs, le plus souvent grimés ; en second lieu, parce que l’histoire qui nous est contée baigne dans une atmosphère aux tonalités nostalgiques. Les scintillements répétés du soleil, à travers les frondaisons des arbres, à la surface aqueuse des piscines, agissent sur la rétine comme le crépitement d’un été féerique mais agonisant. Un homme, incarné par un Burt Lancaster vieillissant, décide de regagner son domicile en plongeant dans chacune des piscines qui jalonneront son parcours, un peu comme s’il remontait le cours d’une rivière (du temps). On comprend vite que les piscines se révèlent être en réalité des occasions pour notre Ulysse des temps modernes d’échanger quelques civilités avec ses voisins. Plongeon après plongeon, ce nageur est progressivement confronté à un cruel dévoilement. L’eau des piscines successives agit comme les multiples bains d’un développement photographique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cliché final, sorte de polaroid de l’existence de notre athlète, ne correspond pas du tout à l’idée qu’il se faisait de sa condition. L’un des passages les plus intrigants du film se situe au moment où il rencontre, aux abords d’une piscine désaffectée, un petit garçon – symbole de son enfance, probablement. Au contact de cet enfant, le nageur convoque son imagination pour simuler le franchissement d’un espace dénué d’eau, – donc de souvenirs. Ce film soulève une idée qui me paraît viscéralement juste, à savoir qu’avec le cumul des années, nous subissons les effets d’un mal sournois, implacable. Une affection qui s’apparenterait à une forme d’amnésie. Dans une certaine mesure, certaines de mes peintures tendent à accréditer ce terrible constat, par l’utilisation du recouvrement – comme c’est le cas avec Octobre2 –, ou de la désagrégation du motif – ce que montre Novembre3. Plus on avance en âge, plus la convocation de nos souvenirs se fait avec une aisance affaiblie. On assiste, impuissant, à la prolifération de zones mortes. Bientôt, des noms disparaissent du tableau, puis des visages s’évanouissent dans un néant ouaté, puis c’est au tour des sons de se confondre en une note de grisaille et, enfin, les odeurs se dérobent discrètement, sans laisser d’adresse. Et, dans ce processus inéluctable d’affaissement des données, on remarque que l’aspect visuel est, hélas, le plus friable. Mais alors, comment combattre ce funeste passager qui sabote notre mémoire, année après année ?
Parmi toutes les pistes que j’ai pu explorer, il en est une qui surnage – c’est celle de la rêverie. C’est pour cette raison que je sollicite souvent des ouvrages ou des films qui ont pour cadre l’enfance. L’enfance possède une imagination plus souple, d’une élasticité poignante et galvanisante. Elle porte en elle un imaginaire qui peut déjouer les avaries du temps, qui survole les précipices de la page blanche d’une vie à écrire. Un autre film, que j’affectionne beaucoup, met en lumière la manière avec laquelle le recours à la fantaisie est capable de colmater les béances de la mémoire. Il s’agit de Cybèle ou les dimanches après-midi de ville d’Avray, réalisé par Serge Bourguignon en 1962, et c’est à nouveau un enfant qui vient en aide à la mémoire défaillante d’un être en errance grâce au puissant pouvoir de l’imagination. Vous ne serez donc pas surpris qu’un poète comme Jules Supervielle me soit attachant, tout comme un auteur tel que Ray Bradbury. On y retrouve des thèmes qui m’importent comme l’absence, la disparition, la survivance du souvenir. Que ce soit aux creux des fonds marins ou dans les nappes cotonneuses d’un ban de nuages en migration, des créatures ou entités apatrides tentent, en vain, de se rappeler aux bons souvenirs des vivants. Ces spectres composent le peuple de nos souvenirs.
La technique qui consiste à circonscrire un lieu par de multiples descriptions est un procédé qui n’est pas éloigné de la méthode de Giorgio Morandi ou de Pierre Bonnard, deux peintres réputés pour l’étroitesse des liens qu’ils entretiennent avec la mémoire. C’est comme s’il s’agissait de faire subir plusieurs lavages à un motif afin d’en extraire la mémoire des teintes – dans le secret dessein de perpétuer un fragment de paysage. Dans le cas de Giorgio Morandi, j’ai appris qu’il avait été sujet à une forte dépression lors de sa mobilisation en 1915. Contraint à une forme d’immobilisme, sa seule distraction devait se résumer à l’observation de flacons sur la table de chevet, à apprécier la lente progression des rayons du soleil sur la modeste colonie des objets de sa chambre. Vous êtes là, allongé dans une pièce, à l’écoute d’une nature absente, attentif à la danse silencieuse de minuscules grains de poussière nimbés de lumière matinale. Le temps s’imprègne en vous, les impressions de cette matinée, lentement, infusent dans votre mémoire. Et là, soudain, vous réalisez que la lumière draine en son sillage des particules de souvenirs. Comment emprisonner ces précieux témoins d’un quart d’heure, ou d’une heure de votre vie ? – telle pourrait être la question. Cet épisode de l’existence de Morandi exhale comme un parfum proustien. Il me semble qu’un des secrets de la peinture de Giorgio Morandi se situe là. D’autre part, jadis, j’avais la certitude que les nombreuses notes que Pierre Bonnard griffonnait dans ses carnets n’étaient que des indications d’ordre pratique comme, par exemple, l’incidence de l’éclat d’un soleil printanier sur des amandiers en fleurs, ou encore l’implication de l’ombre de lourds nuages sur des bosquets endormis. Mais aujourd’hui, je me demande si ces annotations ne correspondaient pas, aussi, à une démarche de chasseur de souvenirs. Tout comme le ferait un entomologiste. Relever méticuleusement les détails du décor d’un bonheur évanoui, dans l’unique but de réanimer, à la manière d’un docteur Frankenstein, les plus beaux instants du passé. J’aime à croire que mon hypothèse n’est pas si éloignée de la vérité. Le fait que son épouse conserve de toile en toile une jeunesse éternelle, et cela malgré les outrages du temps, pourrait bien constituer un indice. Il me semble que le rapport qui relie une photo de notre passé aux souvenirs que nous en avons conservé est fort ténu ; il plane au-dessus de la photographie comme une ombre rebelle. C’est pour cette raison qu’il est peut-être préférable, à l’instar de ces deux artistes, de se cantonner à des petites choses, des balises à la banalité quotidienne.
J-Ch. V. La progression de la lumière sur un mur, la question du détail, semblent amener logiquement à vos peintures débutées en 2015, considérées à tort comme un tournant de votre pratique, délaissant le figuratif au profit d’une supposée abstraction. Or, il n’a jamais été question pour vous d’abstraction dans votre peinture.
J-Ch. E. En 2016, la galerie Claire Gastaud m’avait consacré une exposition où l’on pouvait découvrir quelques petites toiles d’apparence abstraite. C’est à cette occasion que j’ai pu expérimenter une approche sérielle d’un motif défini. Comme je le rapporte dans le texte qui accompagnait cette exposition, c’est à la suite d’une expérience personnelle que j’avais eu l’idée d’utiliser le procédé de la répétition. Mon intention était d’user de la déclinaison d’un motif comme d’un attrape rêves/souvenirs. Toute approche clinique de sérialité pouvait mettre en péril l’intention première de cette démarche. Voilà pourquoi je m’étais attaché à soigner tout particulièrement la confection des teintes. Quand j’évoque la confection des teintes, je fais allusion à la contrainte que je me suis fixée dès mes années de formation à l’Ecole des Beaux-arts. Dans ces années-là, un ouvrage était fort prisé par les étudiants, Les règles du jeu / Le peintre et la contrainte de Jean-Marc Huitorel. Non seulement le culte de la couleur résonnait comme un dogme dans nos ateliers, mais la fascination pour les protocoles de réalisation était partagé par beaucoup d’entre nous. J’ajouterais que les modus operandi d’artistes comme On Kawara ou Luc Tuymans m’avaient fait forte impression. Une peinture par jour, voilà un concept qui me paraissait relever de l’exploit ! Dans le même esprit, j’avais trouvé engageant de restreindre ma palette aux trois couleurs primaires, plus le blanc, pour exécuter mes tableaux. C’est un parti pris qui s’est révélé plutôt réjouissant, car on y retrouve, comme en écho, la gamme des sept notes musicales. D’une contrainte, on aboutit à une sorte de pouvoir démiurgique qui vous apporte beaucoup de satisfaction. C’est aussi, malgré tout, une forme d’ascèse qui vous amène à vous concentrer sur chaque projet avec humilité.
Pour en revenir à ces petites peintures sur panneau de bois, si j’étais conscient qu’il y avait une part d’inconnue dans cette proposition plastique, j’étais bien loin de m’imaginer que, de manière souterraine, une dose de rêverie s’était frayée un chemin à travers les cellules de ces peintures aux allures si maîtrisées. Des nuances longtemps endormies dans les plis de ma mémoire avaient refait surface, se déjouant des règles du jeu. Ma surprise vint de la provenance des coloris. J’ai comme le sentiment que la gamme chromatique des petites peintures, en apparence abstraite, de la série « Area »4 prennent leur source dans les soubassements d’une mémoire enfantine. Ce spectre chromatique s’inspire simultanément de la couleur des murs5 et des sols6 de mes jeunes années. Avant la déclinaison des « Area », Volume7 mettait l’accent sur l’aspect sculptural d’une feuille de papier froissée. Le plâtre me paraissait le matériau le plus adéquat pour transposer avec douceur et en trois dimensions ce dialogue entre ombre et lumière. J’ai donc réalisé quelques volumes8 à la structure épurée. J’avais dessein qu’ils correspondent avec les peintures. Jetées ainsi en pâture à la lumière crue du jour, la structure de ces éléments devait évoluer, avec la course des heures, à la manière d’horloges solaires. Pour la série « Area », je constate que les ocres, les roses et le vert d’eau font directement référence au lieu du rêve par excellence – le lit. Les couleurs de ce vaisseau improvisé qui berce vos rêves et vos cauchemars est aussi le lieu où naissent les plus beaux voyages – ceux de la lecture. Ce sont des couleurs rémanentes qui flirtent avec celles d’un très ancien tableau qui s’avère être rétrospectivement une peinture programmatique, Sous le lit9, peint en 2004. On y voit un lit de profil et, sous ce lit, un objet qui pourrait être une boîte. C’est l’exemple même de lit qu’on trouvait à l’infirmerie ou dans les dortoirs de mon pensionnat. Les couleurs des couvertures étaient à dominante brune, rose, vert d’eau, ou grise. Autant de couleurs, synonymes de sécurité, mais surtout d’évasion pour moi. S’il existe un lieu propice aux songes, à la méditation, à l’observation, et aux savoureuses séances de lecture, c’est bien celui-ci. C’est aussi un merveilleux paratonnerre qui attire les souvenirs, grâce à la proximité des rêves, je suppose. « La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel. » Si l’on gratte un peu le vernis romantique de ce vers tiré du poème Le Cygne de Charles Baudelaire, n’aperçoit-on pas le noir anthracite de la mélancolie ? C’est en me remémorant ce vers que j’en suis venu à inverser la proposition que nous soyons hantés par nos souvenirs. Et si nous étions plutôt des fantômes errants, avec nos baluchons remplis de souvenirs, et que ce soit nous qui hantions les lieux de notre enfance à trop vouloir leur redonner vie ? C’est pour cette raison que les rêves prennent tant de place. Au final, ce ne sont pas les souvenirs qui s’effacent mais nous qui nous effaçons de nos souvenirs. Et peindre, c’est un peu apprendre à disparaitre, à s’effacer. L’image qui se corrompt, cette vision qui se dissout, ce motif qui se dérobe par effritement, par recouvrement, ce n’est pas un souvenir qui s’évanouit mais un souvenir qui nous absorbe sous la houlette du temps. Quant aux titres des peintures et leur connotation mélancolique, ce sont pour la plupart des bribes de vers que j’ai empruntés à des poètes tels qu’Emily Dickinson, Sylvia Plath ou W. B. Yeats. Des poètes qui, leur flambeau brandit bien haut, vous permettent d’avancer dans les ténèbres.
J-Ch. V. Vous évoquiez la peinture Sous le lit, peinte en 2004 alors que vous étiez tout juste diplômé de l’Ecole des Beaux-arts, dont vous soulignez la dimension programmatique. J’ai choisi de faire figurer celle-ci à la toute fin du livre car, contre toute attente, il me semble que vos dernières peintures réalisées en 2020 provoquent un retour sur les commencements de votre oeuvre. La touche redevient maigre, la gamme chromatique renoue avec les dominantes de brun de vos débuts. Les sujets eux-mêmes semblent se faire écho, dans une nostalgie ou une mélancolie sans doute plus prégnantes encore et un assentiment supplémentaire accordé à de petites choses, de petits objets fortuits disposés dans des compositions plus fragmentaires, plus disloquées également.
J-Ch. E. La résurgence des ocres et des violets sur ma palette est imputable à la série « Area ». Dés 2013, j’avais commencé à m’interroger sur la légitimité de certaines couleurs, en particulier les verts. Le triptyque des Murs10 devait pacifier le dessin pour que je puisse mieux réfléchir aux choix des couleurs. D’ailleurs, avec un peu de recul, je remarque que le thème de la construction refait surface à chaque fois que la nécessité de consolider mon ouvrage s’impose. Par exemple, avec des années d’écart, Octobre et le triptyque des Murs s’inspirent du même pan de mur de parpaings. L’image du mur n’est pas un obstacle en soi, mais plutôt une occasion de réinterroger le motif, l’ADN des couleurs. C’est pourquoi il y a une première modulation chromatique dans des peintures datant de 2014 comme Shadows Of Prophecy11, avec son tapis de végétation tirant vers le bleu. Puis la sélection des tonalités s’est poursuivie, comme on peut le voir avec 5 Lines, Volume ou Piece12.
Les dernières peintures renouent avec une figuration plus pathétique, mais en ayant capitalisée sur les précédentes recherches chromatiques. Comme un animal qui reviendrait inspecter les limites de son territoire, j’examine à nouveau quelques sujets qui me sont familiers, mais avec un regard neuf et un flaire aiguisé. Parmi mes marottes, il en est une qui s’est réveillée à la lecture d’Anatomie de l’horreur de Stephen King. Il s’agit de l’épineuse question de la limite de perception. Dans son livre, Stephen King rapporte une rumeur concernant la fin du film X: The Man With The X-Ray Eyes (L’Horrible cas du docteur X) de Roger Corman sorti en 1963. Le film met en scène la cauchemardesque descente en enfer de Milland, un savant qui vient de mettre au point un collyre aux vertus sensationnelles, décuplant la vision au point que Milland peut désormais voir à travers les vêtements, les corps et les murs. Mais il demeure convaincu qu’en poussant plus avant son expérience, cette invention lui permettra de contempler ce que l’homme n’a jusqu’alors jamais pu entrevoir. Et c’est alors que se produit l’inévitable : tel Icare refoulé des cieux après s’être trop approché du soleil, Milland est contraint de s’arracher les yeux tant l’horreur qui souille sa vision lui est insupportable, même les yeux clos. La rumeur à laquelle fait allusion Stephen King est celle qui prétend que Milland, après s’être automutilé, se serait écrié « Je vois encore ! ». Au final, Roger Corman aurait renoncé à insérer cette dernière réplique dans son film, tant cette conclusion devait lui paraître insoutenable. Comment ne pas être horrifié devant une telle perspective qui menace la raison et soulève une kyrielle d’interrogations ? Que voit-on réellement de ce qui nous entoure ? Et comment le perçoit-on ? Est-il plus important de voir ce qui se trouve au-delà d’un pan de mur ou ce qui gravite à sa périphérie ? Ne devrait-on pas nous soucier davantage de ce qui se meut hors champ ? Un détail, anodin en apparence, peut se révéler d’une importance capitale. Et nous ne sommes jamais à l’abri de la reptation d’un phénomène porteur de surprise, d’émerveillement. Si cette chose peut se présenter sous la forme d’une monstruosité ou d’une incongruité comme dans les films de David Lynch, elle peut aussi se matérialiser sous une apparence réconfortante, apaisante. C’est pour cela que j’accorde autant d’importance à ce qui se passe sur un tableau qu’à ce qui l’avoisine – et je ne parle pas uniquement de ce qui se trouve à sa proximité immédiate, mais aussi à ce qui se situe à sa proximité psychologique, affective.
Naguère, je souhaitais que mes peintures agissent comme des lierres vivaces qui étendraient leurs ramifications dans l’esprit de ceux qui les observent. Mais aujourd’hui, mon unique souhait serait qu’elles suscitent chez eux d’autres images. Des images avec lesquelles ils pourraient poursuivre leur promenade avec, en poche, un petit recueil de poèmes aux coins usés…